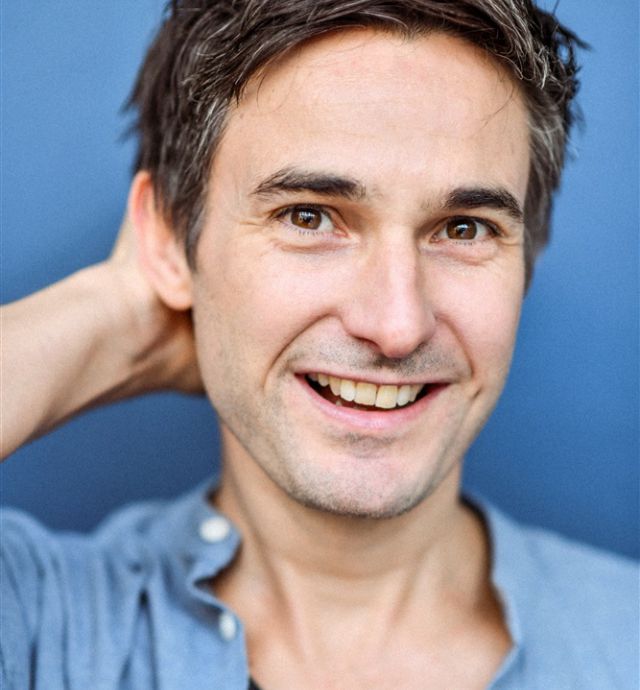Brice Hillairet pour « La Machine de Turing »
Reprise du rôle titre dans « la machine de turing » au Michel
Brice Hillairet (Molière de la révélation masculine 2020) reprend le rôle d’Alan Turing dans « La Machine de Turing » après Benoît Solès (auteur de la pièce) et Matyas Simon. Il nous raconte comment il cherche sa propre ligne, entre précision du texte, intime et engagement du corps.
Comment êtes-vous venu au théâtre ?
Je viens de Nîmes. À 18 ans, je me suis rendu au Cours Florent pour étudier la seule chose qui m’intéressait : le théâtre. Il y a ensuite eu des premiers spectacles, notamment jeune public avec Georges Beco, puis Perthus au Vingtième Théâtre, La Souricière à la Pépinière et plus récemment Hedwig and the Angry Inch à la Scala, dernière étape qui m’a menée jusqu’à Turing.
Quel est votre souvenir en tant que spectateur de La Machine de Turing ?
Je l’avais vue à sa création, en 2018. Je me souviens m’être dit : quel rôle merveilleux, écrit au cordeau, ambitieux et ample. Mais je ne me projetais pas du tout dedans. Je voyais surtout Benoît Solès, un auteur et un acteur qui aime les grands textes et assume l’ambition dramatique. Quand il m’a appelé pour me confier Turing, j’ai été profondément touché : me proposer une telle partition est un signe de confiance rare.
Qu’est-ce qui rend ce rôle intéressant à jouer ?
Je dirais sa complexité. Aussi, un texte très écrit, une adresse publique centrale, et un Turing qui traverse des états passant autant par le dedans que par l’action : la pensée fulgurante, la gêne sociale, l’enfance qui affleure, la blessure. C’est aussi un rôle physique : un corps tendu, nerveux, que traverse parfois une liberté d’enfant.
Comment reprenez-vous un rôle créé par d’autres ?
Je me suis d’abord imprégné de la mise en scène pour en comprendre l’architecture, grâce aux captations. Ensuite, sous la direction de Tristan Petitgirard, j’ai retrouvé les déplacements dans mon propre corps : l’idée ici n’est pas de reproduire, mais de recréer. Il y a aussi le bégaiement, que j’ai dû chercher à mon endroit, sans le plaquer, pour qu’il surgisse là où la respiration et la pensée l’exigent.
Y a-t-il un passage que vous aimez particulièrement ?
Tous les moments où il parle d’amour. Un amour contrarié, endeuillé, ça me bouleverse. Je n’ai pas encore de réplique-totem, mais je sais que ces scènes irriguent tout le reste : elles donnent sa vibration au rôle.
Quelle relation entretenez-vous avec l’IA ?
Je suis un laborieux et un lent. J’arrive toujours après la vague, même pour le smartphone… que j’ai adopté tardivement. Quant à l’IA, je suppose que je finirai par y venir, comme tout le monde, par nécessité. J’aimerais en tout cas que l’écran ne m’aspire pas : l’éteindre plus souvent, ne pas le consulter de façon machinale.
Comment appréhendez-vous la première ?
Avec une fébrilité maximale, et l’assurance d’une magie qui n’advient qu’avec le public. On répète face au vide ; la première remet l’adresse à sa juste place. Au Michel, l’intimité salle-scène est idéale pour ça.
Un mot de la fin ?
Ne donnons pas au public ce qu’ils attendent. Donnons-leur ce qu’ils attendent… sans le savoir encore !
Par Sophie Geneste