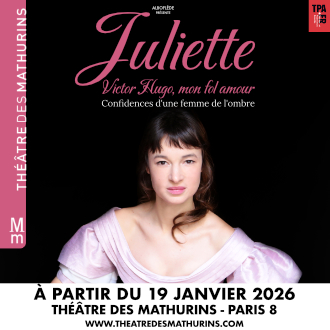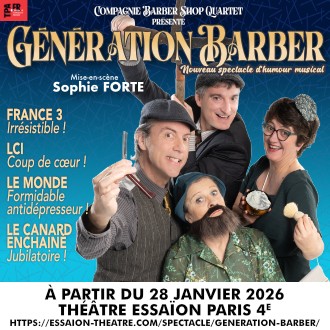Les raisins de la colère
Porté par le désir d’explorer les grandes fresques humaines, entre destin collectif et itinérance intime, Xavier Simonin retrouve ici son complice Jean-Jacques Milteau pour adapter l’un des monuments de la littérature américaine. Ce « road théâtre » fait vibrer la puissance du texte grâce à la musique des routes et des migrations, où blues et folk deviennent le souffle même du récit.
 Pourquoi et comment avoir choisi d’adapter Les Raisins de la colère, un roman aussi emblématique que sensible, sous un angle particulier : la musique ?
Pourquoi et comment avoir choisi d’adapter Les Raisins de la colère, un roman aussi emblématique que sensible, sous un angle particulier : la musique ?
La genèse de ce projet vient de notre précédent spectacle, L’Or de Blaise Cendrars, que j’ai monté avec Jean-Jacques Milteau. Ce qui ne devait être que quelques représentations s’est transformé en dix ans de tournée, et cette aventure a créé des liens forts. Nous avons voulu prolonger cette histoire avec une nouvelle œuvre et notre choix s’est porté sur Les Raisins de la colère. Obtenir les droits a été un long chemin, tant le roman et le film de John Ford sont sacralisés, mais après quatre ans de démarches, nous y sommes parvenus. Cette fois, Jean-Jacques n’est pas sur scène : il assure la direction musicale et réunit un trio de musiciens autour de moi. Sa culture du blues et des musiques nées de la migration sur la Route 66 rejoint mon envie de raconter la vie de ces personnes en exil. Ayant grandi en Afrique et animé depuis plus de dix ans une association dans le Sahel, ces thématiques résonnent particulièrement pour moi. Nous nous retrouvons donc autour de ce récit d’itinérance et de la musique qui l’accompagne.
 Pourquoi un spectacle bilingue ? Comment techniquement ?
Pourquoi un spectacle bilingue ? Comment techniquement ?
Au départ, je voulais que la pièce passe progressivement du français à un texte entièrement en anglais. Mais parler un anglais parfait, sans être natif, risquait de desservir l’œuvre de Steinbeck. Finalement, c’est la musique qui a permis cette transition. Jean-Jacques Milteau a imaginé une tracklist mêlant grands classiques américains de l’époque – certains cités dans le roman – et chansons originales. Claire Nivard et Glenn Arzel ont ainsi mis en musique des extraits de chapitres que j’ai souhaité conserver en anglais.
Qu’avez-vous exploré de nouveau dans cette collaboration renouvelée avec Jean-Jacques Milteau ?
Tout le défi d’une adaptation est d’apporter du nouveau sans trahir l’œuvre originale ni l’esprit de l’auteur, qui reste notre matière première. La musique permet justement de raconter autrement. Dans L’Or, nous n’étions que deux sur scène avec Jean-Jacques : quelques notes d’harmonica suffisaient à nous transporter sur les rives du Mississippi et traduisaient les descriptions du roman. Nous avions inventé un dialogue entre théâtre et musique, un jeu qui nous a passionnés et que nous avons voulu réinventer dans Les Raisins de la colère. Cette fois, le travail était plus complexe mais aussi plus riche : je partageais ma vision de la mise en scène, et Jean-Jacques la traduisait musicalement en guidant les musiciens. Il fallait les transformer en acteurs de la narration à travers les chansons, des effets sonores et parfois même des bruitages.
« COMME TOUTE GRANDE ŒUVRE, IL TRAVERSE TOUTES LES ÉMOTIONS ET DEVIENT UN MIROIR DE NOTRE RÉALITÉ »
Comment le travail collectif avec les musiciens Claire Nivard, Mary Reynaud, Stephen Harrison, Sylvain Dubrez, Manu Bertrand et Glenn Arzel nourrit-il la narration ?
Les musiciens sont là à plus d’un titre : ils sont à la fois là pour créer une ambiance musicale, un peu comme la bande-son d’un film ; et ils sont là en live pour interpréter des chansons, un peu comme dans un concert. Il y a aussi eu un travail d’actorat à réaliser. Ils ont dû apprendre à bouger et à incarner, même sans avoir de texte à proprement parler. Il fallait réaliser des tableaux vivants. Même leurs instruments peuvent parfois être des éléments de décors naturels ! La rencontre entre eux et moi est rythmique, car in fine, nous sommes tous dans nos univers. Chacun est à l’écoute de l’autre, pour trouver la bonne tonalité générale. Tout cela est sonorisé par des micros d’époque, afin de créer une ambiance authentique. Les musiciens jouent et chantent tous dans un micro unique et se modulent au-devant de celui-ci en fonction du morceau et de la musicalité. Ces micros sont aussi de très belles pièces et font partie intégrante du décor.
Qu’apporte la forme de « road théâtre » à l’histoire des Joad ?
L’idée de « road théâtre » s’inspire du « road movie » : comme les Joad sur la Route 66, le spectacle avance d’un lieu à l’autre – une ferme, un bistrot, la route, un camp de migrants – grâce à un décor volontairement simple qui nourrit l’imaginaire, porté par la musique et le jeu. J’ai choisi quelques objets évocateurs, caisses en bois, louches, lampes tempêtes, pour signer l’ambiance. Les costumes, créés sur mesure par Aurore Popineau à partir de textiles d’époque, renforcent encore l’authenticité, tout comme les lumières de Bertrand Couderc. Avec le texte et la musique au centre, tous ces éléments tissent une atmosphère immersive, invitant le spectateur à voyager sur la route et dans l’époque.
Qu’attendez-vous de la ren contre entre le public d’aujourd’hui et du message porté par un texte aussi puissant et intemporel que celui de Steinbeck ?
contre entre le public d’aujourd’hui et du message porté par un texte aussi puissant et intemporel que celui de Steinbeck ?
La pièce résonne forcément avec notre époque, en évoquant le dérèglement climatique, la crise économique ou les migrations. Mais pour moi et la troupe, l’essentiel était surtout de faire vivre ce texte magnifique. Comme toute grande œuvre, il traverse toutes les émotions et devient un miroir de notre réalité, où chacun peut s’attacher à une scène ou à un personnage. C’est ce que permet le théâtre : offrir un moment unique, à la rencontre d’un récit vivant qui nous questionne et nous émeut. C’est cela que nous voulons partager avec le public.
Par Caroline Guillaume